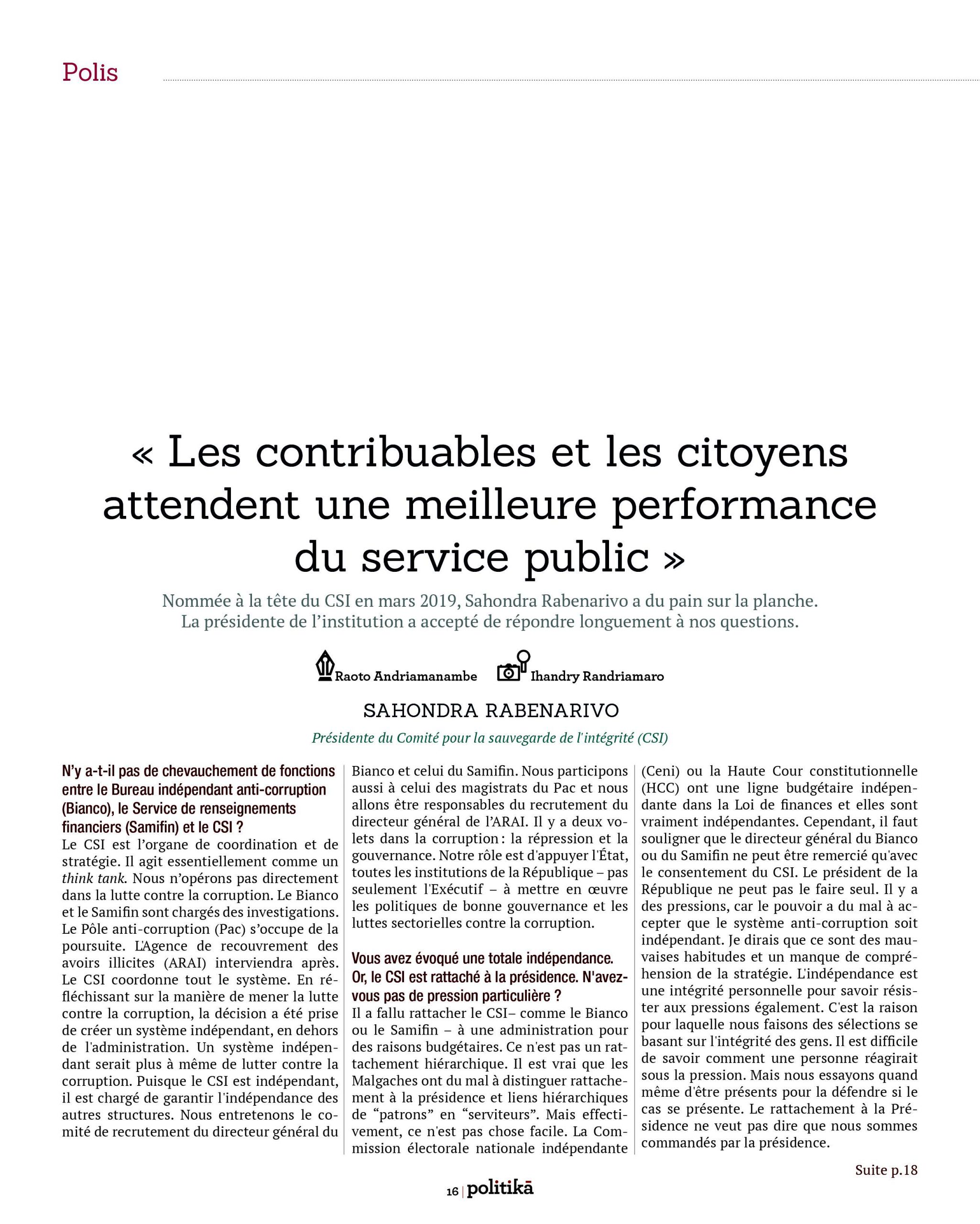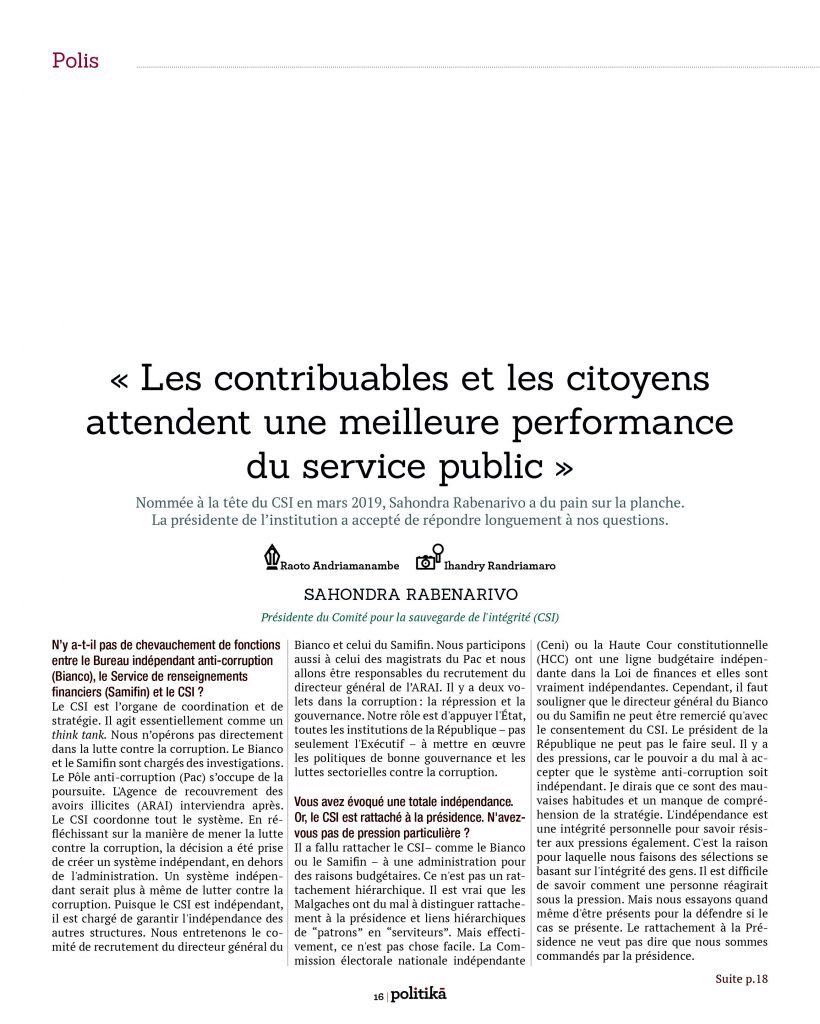Nommée à la tête du CSI en mars 2019, Sahondra Rabenarivo a du pain sur la planche. La présidente de l’institution a accepté de répondre longuement à nos questions.
N’y a-t-il pas de chevauchement de fonctions entre le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), le Service de renseignements financiers (Samifin) et le CSI ?
Le CSI est l’organe de coordination et de stratégie. Il agit essentiellement comme un think tank. Nous n’opérons pas directement dans la lutte contre la corruption. Le Bianco et le Samifin sont chargés des investigations. Le Pôle anti-corruption (Pac) s’occupe de la poursuite. L’Agence de recouvrement des avoirs illicites (ARAÏ) interviendra après.
Le CSI coordonne tout le système. En réfléchissant sur la manière de mener la lutte contre la corruption, la décision a été prise de créer un système indépendant, en dehors de l’administration. Un système indépendant serait plus à même de lutter contre la corruption. Puisque le CSI est indépendant, il est chargé de garantir l’indépendance des autres structures. Nous entretenons le comité de recrutement du directeur général du Bianco et celui du Samifin. Nous participons aussi à celui des magistrats du Pac et nous allons être responsables du recrutement du directeur général de l’ARAI. Il y a deux volets dans la corruption: la répression et la gouvernance. Notre rôle est d’appuyer l’État, toutes les institutions de la République – pas seulement l’Exécutif – à mettre en œuvre les politiques de bonne gouvernance et les luttes sectorielles contre la corruption.
Vous avez évoqué une totale indépendance. Or, le CSI est rattaché à la présidence. N’avez-vous pas de pression particulière ?
Il a fallu rattacher le CSI – comme le Bianco ou le Samifin — à une administration pour des raisons budgétaires. Ce n’est pas un rattachement hiérarchique. Il est vrai que les Malgaches ont du mal à distinguer rattachement à la présidence et liens hiérarchiques de “patrons” en “serviteurs”. Mais effectivement, ce n’est pas chose facile. La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) ou la Haute Cour constitutionnelle (HCC) ont une ligne budgétaire indépendante dans la Loi de finances et elles sont vraiment indépendantes. Cependant, il faut souligner que le directeur général du Bianco ou du Samifin ne peut être remercié qu’avec le consentement du CSI. Le président de la République ne peut pas le faire seul. Il y a des pressions, car le pouvoir a du mal à accepter que le système anti-corruption soit indépendant. Je dirais que ce sont des mauvaises habitudes et un manque de compréhension de la stratégie. L’indépendance est une intégrité personnelle pour savoir résister aux pressions également. C’est la raison pour laquelle nous faisons des sélections se basant sur l’intégrité des gens. Il est difficile de savoir comment une personne réagirait sous la pression. Mais nous essayons quand même d’être présents pour la défendre si le cas se présente. Le rattachement à la Présidence ne veut pas dire que nous sommes commandés par la présidence.
Vous parlez d’intégrité. Y a-t-il des indicateurs pour mesurer l’intégrité d’untel ou un tel candidat à un poste à responsabilité ?
Nous essayons de découvrir parmi les candidats quelles pourraient être les failles exploitables ainsi que leurs vulnérabilités. L’aspect psychologique est primordial, car l’amour de l’argent ou du pouvoir est très nuisible dans la conduite des missions. Pour l’instant, les enquêtes de moralité nous aident, mais elles ne sont pas suffisantes pour percevoir la capacité d’une personne à résister à la pression. C’est justement l’essence de l’intégrité: un morceau qui n’est pas cassé, qui n’a pas de fissures et qui n’a pas de failles exploitables. Il faut une certaine indépendance par rapport à l’argent et le pouvoir. Il est important d’avoir une assise et une indépendance morales.
Le rôle du CSI est aussi de développer le Système national d’intégrité (SNI), qu’est-ce qui se cache derrière ce terme un peu abscons ?
Si vous regardez le logo, neuf piliers y sont représentés. Ils incarnent les piliers de la gouvernance et de l’intégrité. Chacun a un rôle à jouer pour que l’État de droit – qui est le toit de l’édifice – ne tombe pas et pour que l’équilibre soit maintenu. Avec neuf piliers, un ou deux peuvent vaciller, mais l’ensemble ne va pas s’écrouler. Notre objectif est de les consolider afin de renforcer l’État de droit. Tout le monde doit participer même si c’est difficile.
Aujourd’hui, lesquels de ces piliers sont faibles ?
La politique et le système judiciaire sont friables. Le système judiciaire n’est pas politique mais participe à l’organisation de l’État. Les élus, les gouvernants et le personnel judiciaire en sa totalité en font partie. Le système anti-corruption essaye tant bien que mal de remplir ses missions, mais il n’est pas encore suffisamment fort et omniprésent.
Vous avez évoqué un point essentiel : l’intégrité de la justice. Que faut-il faire pour que les citoyens aient de nouveau confiance dans la justice ?
Chaque secteur doit avoir sa propre politique de lutte contre la corruption. Les enjeux sont souvent spécifiques à chaque ministère. On ne peut effectuer les mêmes approches pour tous. Cela implique une vraie volonté d’internaliser la lutte contre la corruption, d’identifier à quel stade les risques de corruption sont-ils les plus importants et puis, de mettre en œuvre une vraie politique. Cela prendra du temps. À la fin nous instaurerons un service public performant, transparent et qui ne choisit pas entre “ceux qui paient et ceux qui ne le font pas”. C’est un travail de longue haleine. Il y a une tendance lourde à penser que seul le système anti-corruption œuvre pour lutter contre la corruption et que les habitudes doivent demeurer. Cela ne doit plus être le cas. Maintenant, il faut que cette notion de justice soit internalisée. Chaque ministère doit rendre opérationnelle sa cellule anti-corruption, car les réalités sont différentes dans les volets éducation, environnement, économique…
Dans votre dernier rapport, vous faites mention de l’ordonnance de recouvrement des avoirs illicites. Promulguée en 2019, cette ordonnance constitue le dernier pas dans l’arsenal juridique prévu par la Stratégie nationale de lutte contre la corruption 2015-2025. Elle est l’aboutissement d’un long processus qui a débuté fin 2015. L’esprit de ce texte est la récupération par l’État des biens illicitement acquis. Des dossiers sont-ils instruits actuellement ?
La Loi sur le recouvrement des avoirs illicites a été rejetée par le Parlement lors de sa deuxième session de 2018 et en 2019. Peu après ma nomination, nous avons encouragé le président de la République à légiférer par voie d’ordonnance. C’est ce qu’il a fait. Nous avons travaillé ensemble pour faire passer le texte en Conseil des ministres. Grande fut la surprise quand l’ordonnance a été publiée : il fallait sa ratification par le Parlement. En juillet 2019, nous avions pensé que les décrets d’application de la création de l’agence de recouvrement allaient être pris. Cette ratification n’était pas dans la décision de constitutionnalité de l’ordonnance sur le recouvrement des avoirs illicites, mais dans une autre décision qui avait approuvé la délégation de pouvoirs. Même le gouvernement avait quelque peu omis ce point de détail. Il a donc fallu attendre la session extraordinaire du mois de février pour la ratification, et là encore le texte a failli ne pas passer. Ce n’est qu’en juillet 2020, en pleine pandémie, que la HCC a sorti la dernière décision et que l’ordonnance est entrée en vigueur. Pour le CSI, la priorité est de sortir le décret d’application avant la fin de l’année. Nous devrons lancer le processus de recrutement du directeur général de l’ARAI pour le premier trimestre 2021. Nous sommes en train de programmer pour la Loi de finances initiale le budget d’installation et de mise en place de l’agence de recouvrement. C’est la dernière boucle. Vous avez compris le problème inhérent à la volonté politique. Le Parlement avait rejeté la loi tout comme celle sur le blanchiment de capitaux qui n’a été adoptée que durant le deuxième tour de la session parlementaire de 2018. L’adoption des textes devrait être l’étape la plus facile, mais ce n’est pas le cas. Maintenant que le Pac a été mis en place, “ils” essaient de défaire cet édifice.
Vous évoquez des questions de pratiques politiques, notamment en parlant du fait d’arme de nos députés sur la proposition de loi sur le Pac. La plupart de nos politiciens sont d’abord des businessmen qui font de la politique pour pérenniser leurs activités. Après, ils font barrage aux lois novatrices qui pourraient entraver leur business. N’y a-t-il pas une question d’éthique et d’intégrité qui serait à considérer ?
Il y a absolument une réflexion à faire sur cette situation, en parlant du lien entre la gouvernance électorale et l’élection. Si l’on se fait élire, l’on doit rembourser celui qui a financé la campagne : c’est le quid pro quo. Et c’est peut-être son propre business qui a financé l’élection. Beaucoup d’éléments entrent en jeu. Néanmoins, je suis optimiste même si on avance petit-à-petit. Je sais que de nombreux citoyens sont impatients et aimeraient que les résultats soient palpables immédiatement, mais le travail est de longue haleine. La gouvernance électorale est sans aucun doute un élément très important. Dans les pays développés, quand un nouveau parlementaire entre en fonction, il est encadré. Il bénéficie d’un environnement de formation et de préparation. À Madagascar, durant de nombreuses années, la tendance avait été de penser que tout passait comme une lettre à la poste au sein du Parlement. Maintenant, il est évident qu’un parlementaire doit avoir un peu de bagage législatif. La confection des lois est un vrai travail.
Dans le volet de l’intégrité, pourquoi le CSI n’a-t-il pas réagi dans les affaires qui mettent en cause celle des détenteurs de mandat public, comme l’affaire de sucreries ayant impliqué l’ancienne ministre de l’Éducation nationale ou celle des écrans plats destinés au Centre de commandement opérationnel de la lutte contre la Covid-19 impliquant le ministre de l’intérieur et de la Décentralisation ?
Évidemment, on peut toujours utiliser ces cas comme exemples concrets à l’avenir. Nous ne sommes pas dans l’opérationnel, je ne peux pas commenter ces événements. Par contre, le CSI aimerait faire beaucoup plus en termes de communication, d’éducation et de conscientisation des citoyens. Ceux-là doivent savoir ce qu’est exactement la corruption, qui n’est pas seulement l’extorsion de fonds, mais s’apparente aussi à l’abus de pouvoir, aux conflits d’intérêts…
Dans le futur, nous pourrions illustrer ces exemples avec les cas que vous avez cités, mais il faudrait qu’il y ait un jugement dé finitif. Comme je vous l’ai indiqué, le CSI est un think tank. Quand nous effectuons la revue des stratégies ou l’évaluation des politiques pour permettre d’identifier les points d’achoppement, nous estimons que la célérité des enquêtes et leur efficacité peuvent être améliorées. Dans le volet judiciaire, le Pac a effectué un premier reporting judiciaire qui a mis en relief le nombre de dossiers reçus et le nombre de condamnations. Or, la justice ordinaire n’a pas encore effectué ce genre de démarche. L’exemple que le Pac montre les standards de performance à adopter.
Comment jugez-vous la performance de l’administration ? Est-elle efficace ?
Cette question rappelle la politique sectorielle que j’ai évoquée. Le processus sera difficile, mais il importe qu’il y ait dialogues et discussions ministère par ministère. Une tendance sera de souligner que telle ou telle institution n’a pas suffisamment d’effectifs ou d’infrastructures. Néanmoins, je crois que c’est surtout une manière de travailler que la plupart n’ont pas. Les discussions seront pénibles. Nous allons nous y attaquer à partir de l’année prochaine, dans chaque ministère. Secteur par secteur, la cartographie des risques sera dressée. Je suis convaincue que la plupart des fonctionnaires sont fatigués des pressions et de la corruption et qu’ils aimeraient faire un bon travail. J’ai vraiment hâte de passer à cette étape. Je regrette que la pandémie ait arrêté net tous les efforts que nous avons entrepris.
Sur ce point, quelles leçons doivent être tirées de la gestion opaque de la lutte contre la Covid-19 ?
Hélas, je crois que la leçon est que, sans conditionnalité, on fait n’importe quoi. Il est terrible de constater que ce sont des conditionnalités qui imposent une certaine rigueur. Beaucoup aiment naviguer en eaux troubles plutôt que dans les eaux claires de l’intégrité. Il y a une manière de travailler entre ces deux zones. Cependant, il ne faut pas nous laisser sombrer par les ténèbres dans les eaux troubles.
Où en sommes-nous par rapport à la Loi sur l’accès à l’information ?
La Loi sur l’accès à l’information sera bientôt présentée en Conseil des ministres. Globalement, nous pensons qu’elle contient la plupart de nos recommandations. Mais, encore une fois, comme dans tout autre domaine, ce n’est pas juste le texte qui importe, il faut des mesures d’accompagnement. Cette disposition concerne aussi bien l’information digitale, sur papier que sur autre support. Même si la Grande île n’a pas encore rempli tous les préalables, la première étape serait l’effectivité de la loi. Et puis, sa mise en œuvre, pour qu’elle soit réellement en vigueur pour les deux ou trois prochaines années.
Quelles priorités avez-vous établi ?
Les politiques sectorielles sont prioritaires. Après, nous procèderons au déploiement de la politique nationale de bonne gouvernance, qui a plusieurs volets, dont la gouvernance électorale, la gouvernance parlementaire et la gouvernance économique. Ce sont des domaines imbriqués. D’un côté, il est important de prévenir la corruption. De l’autre, dans de rares cas — car ils devraient être rares — les délits de corruption devraient être sévèrement réprimés.
Pour conclure, vous venez de la société Civile, comment vivez-vous ce mandat public que l’on vous a confié ? Y a-t-il un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous aviez critiqué quand vous étiez membre du Sefafi ?
La résistance au changement est le premier challenge. Je vous signale que je suis bien issue de la société civile, mais aussi du secteur privé. La manière de travailler est différente dans le secteur public en termes d’objectifs, d’évaluation de performance et de plan de travail personnel. La résistance au changement est universelle, mais elle est particulièrement forte dans administration publique. Aujourd’hui, je comprends beaucoup mieux certaines situations. Par exemple, je peux vous décrire l’attachement à des postes grâce à un système de rémunérations et de récompenses pécuniaires très important.
Le voile doit être levé. Juste pour vous dire, par exemple, quand on est directeur général d’un ministère, on bénéficie d’énormes avantages. Ainsi, certains se disent ‘je ne suis à cette place que pour un an, il faut donc que je me remplisse les poches”. L’autre aspect que j’ai découvert est aussi l’accès à la fonction publique.
L’administration est-elle prête pour ce genre de réforme ?
Si nous voulons avancer, il faut que nous soyons prêts à salarier les agents de la fonction publique dans des proportions honnêtes. Les soldes sont toujours les excuses avancées pour justifier la corruption. Quand on parle de service public, les performances doivent être mieux rémunérées. Nous allons vers sa “privatisation” en termes de performance. L’outil digital peut mesurer cette dernière. Il est important de recycler régulièrement la connaissance des agents de l’État. La réforme est possible, mais la résistance est très grande. Les contribuables et les citoyens sont en droit d’attendre une meilleure performance. Vous allez voir que quand nous allons trouver ces “opportunités de corruption”, elles concerneront sûrement les services des impôts, de la pension, des douanes.
N’avez-vous pas peur de buter sur le corporatisme, la solidarité des agents du secteur public, la pression politique.
Peur n’est pas le mot. Je comprends le défi. Le grand public décide. C’est une question de communication et de transparence. Le premier changement de mentalité est de se dire que nous, citoyens, avons le droit à l’éducation, à l’information et à un service public équitable. Maintenant, il faut le réclamer. Je n’ai pas peur, mais je sais que le processus va être difficile.
Texte : Raoto Andriamanambe – Photo : Ihandry Randriamaro
instagram likes kaufen